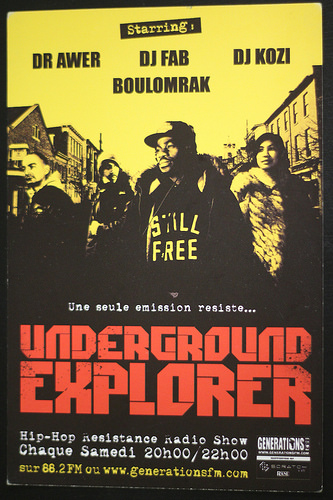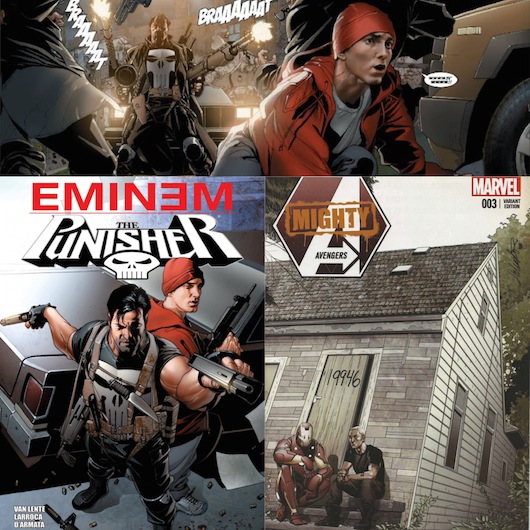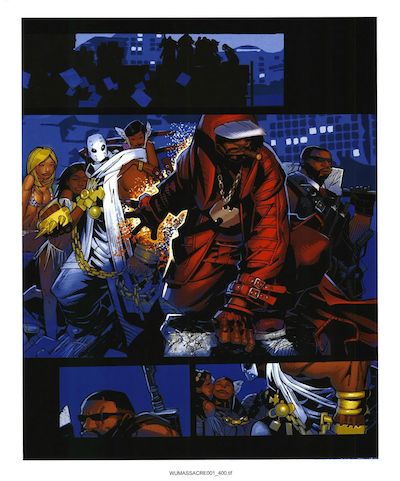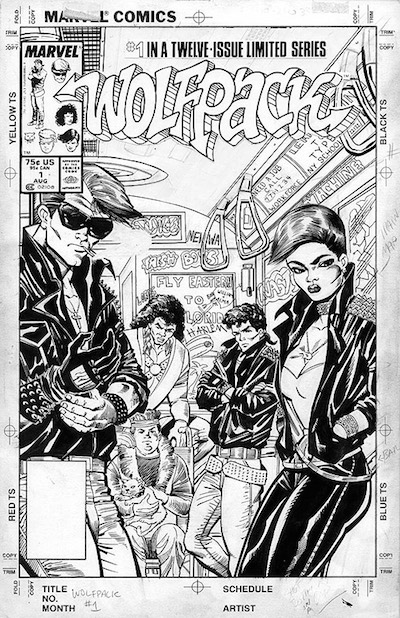Comme indiqué en fin d’article, cet entretien a été réalisé dans un cadre assez inattendu pour une rencontre avec Kent, un vrai “enfant terrible” du rock britannique, côté journalisme et critique. Le festival Livres et Musique de Deauville, aussi qualitatif soit-il, est traversé par une ambiance petite-bourgeoise, dans une ville clinquante hantée par des rockers vieillissants… Nick Kent, rangé des comportements outranciers, n’alluma qu’un seul joint de toute l’interview, mais fut particulièrement affable.

De passage à Deauville pour le Festival Livres et Musique, l’enfant terrible de la… critique rock britannique, Nick Kent. Morrissey sait des choses sur lui « à défriser un afro », mais autant demander au trublion en personne, qui n’a pas perdu son souffle pour nous répondre entre deux bouffées, d’enthousiasme et de tabac.
Vous travaillez en ce moment sur une réédition de Sticky Fingers des Rolling Stones, en quoi cela consiste-t-il ?
Nick Kent : Ces trois dernières années, j’ai bossé avec les Rolling Stones, j’ai fait l’assistant. Mick Jagger m’a appelé, parce qu’ils veulent que des gens plongent dans leurs archives, en vue de les ressortir avec des inédits. Ils ont déjà fait Exile il y a 4 ans, Some Girls aussi, et ils veulent maintenant sortir Sticky Fingers. Sticky Fingers est un album sur lequel il est difficile d’écrire, surtout à propos du processus créatif. Il a été enregistré par phases, et il y a des problèmes judiciaires entre Decca, leur premier label et Atlantic, le suivant, sur lequel allait sortir Sticky Fingers. Les Stones n’étaient pas sous contrat lors de l’enregistrement.
Avez-vous accès à beaucoup d’enregistrements ?
Nick Kent : J’ai accès à toutes leurs archives, et il y des putains de milliers d’enregistrements de cette période. Ils enregistraient toutes les nuits, tout et n’importe quoi. Les archives des Beatles ou de Bob Dylan sont très bien classées : voilà « « Yesterday », takes D ». J’ai passé énormément de temps à écouter ses archives, qui sont majoritairement constituées de vieux blues/jazz. Il faut écouter 8 heures de merde pour trouver 5 minutes d’enregistrements corrects : les Stones étaient comme ça, pouvaient être le pire groupe du monde. En enregistrement, en répétition, si Richards ou Jagger n’étaient pas motivés, c’était horrible.
Cherchez-vous également à recueillir les souvenirs des gens présents ?
Nick Kent : Aucun de ceux qui étaient présents n’a les mêmes souvenirs de ces enregistrements, personne ne se souvient du lieu et de l’endroit où les chansons de Sticky Fingers ont été enregistrées. La batterie ou la guitares ont pu être enregistrées en avril, mais en décembre, ses parties sont à nouveau réenregistrées. Ils jouaient la même chanson pendant des mois. « Can’t You Hear Me Knocking », avec ses 5 minutes de jam, vient de deux sessions : une pour la chanson, et une autre pour le jam avec Mick Taylor. Cet album a véritablement été piloté par Mick Jagger et Jimmy Miller, Keith Richards n’était pas en grande forme à ce moment-là.
Il n’était même pas là pour la moitié des sessions, il ne venait même pas. Mick Jagger jouait de la guitare. Richards est sur Brown Sugar, même si Mick Jagger l’a intégralement écrite, y compris le riff. Il a écrit Wild Horses, et il est dessus. Il est là pour le riff du début de « Can’t You Hear Me Knocking », pendant les 2 premières minutes de la chanson. Mais l’instrumental est assuré par Mick Taylor, Billy Preston, Bobby Keys, Charlie Watson, Bill Wyman. Keith Richards n’est pas souvent là.
Mick Taylor s’en souvient bien, il était dans deux chansons de Let It Bleed, mais Sticky Fingers est son premier album avec les Stones. Marshall Chess, qui était à la tête de Rolling Stones Records, il était là à toutes les sessions. Keith Richards ne se souvient de rien, parce qu’il n’était pas là, ou «absent» pendant les enregistrements. Les 2⁄3 de Exile on Main Street ont été enregistrés pendant les sessions de Sticky Fingers. Ils ont emmené les bandes à Nellcôte, en France, et aux États-Unis. Il y a peut-être six chansons qui viennent de Nellcôte, « Tumbling Dice », « Casino Boogie », « Ventilator Blues », « Happy » et deux autres. Les autres viennent des enregistrements de Sticky Fingers. Les Stones ont toujours enregistré comme cela : Keith Richards pouvait reprendre des enregistrements et refaire la basse. Bill Wyman n’est pas sur beaucoup d’albums des Stones, même s’il était avec eux en live.
À quand remonte votre première rencontre avec les Stones ?
Nick Kent : Je suis né à Londres, mais ma famille et moi avons déménagé au Pays de Galles à mes huit ans. Quand j’avais douze ans, un de mes camarades avait son père qui organisait un événement local de catch, mais aussi des concerts à Cardiff. Il m’a invité à un concert des Rolling Stones, lorsqu’ils n’avaient que deux singles à leur actif, et aucun hit. J’avais douze ans, et je rencontrais les Stones, avec Brian Jones en leader, vingt ans à l’époque, très sympathique. Ils étaient très énergiques, trois concerts par jour.
L’écriture de livrets, les articles du Guardian ou de Libé, ce sont des choses qui vous occupent, à présent ?
Nick Kent : Je suis plus connu pour mes observations sur les groupes dans leur vie commune, ou musicale, mais l’exercice ne me déplaît pas. Je suis un retraité du journalisme print. Je n’ai pas écrit d’articles pour un magazine depuis très longtemps. J’ai aimé The Guardian, ils payaient bien et ne foutaient pas le bordel dans ce que j’écrivais. Probablement un des meilleurs journaux en Angleterre, avec le Times [sa compagne Laurence Romance y publie régulièrement des articles, dernièrement sur Kurt Cobain NdR]. J’ai 62 ans, maintenant, et puis il n’y a plus tellement de groupes avec lesquels je voudrais traîner. Je ne voudrais pas traîner avec Coldplay, U2 ou même les Foo Fighters.
Quand a eu lieu votre rencontre avec Lester Bangs, et quels souvenirs en gardez-vous ?
Nick Kent : J’ai rencontré Lester Bangs en février 1973, quelqu’un m’avait dit où il habitait et je me suis pointé chez lui. Il les avait prévenus de mon arrivée. Je suis arrivé à côté de Detroit, dans une petite ville appelé Birmingham, au milieu d’un grand état comme le Michigan, de là où venait Cream.
J’étais un peu allumé, ils voulaient se débarrasser de moi, je voulais surtout me droguer avec de quoi fumer. Ils ont décidé de me refiler à Lester Bangs, parce que j’étais écrivain. Quelqu’un m’avait filé un tranquilisant, cela s’appellait Mandrax, parce que j’étais nerveux à l’idée de rencontrer Bangs. Du coup, j’avais l’air bourré, ce n’était pas très malin. Je me souviens que nous avions écouté une des premières copies de Raw Power. Iggy et les Stooges me l’avaient joué, très grossièrement, en Angleterre, avant de partir à Los Angeles.
À ce moment-là, vous travaillez déjà au New Musical Express ?
Nick Kent : J’ai eu ce premier boulot au NME très facilement, j’ai été très chanceux. Mais j’ai eu peur que cela ne dure qu’un temps, je voulais m’améliorer, je lui demandais comment il écrivait. Il ne faisait que parler, nous avions des méthodes d’écriture très proches. Lui prenait du speed, et écrivait, écrivait, écrivait comme un obsédé. Il tenait un journal, ce que je ne faisais pas. Je n’écrivais pas de lettres non plus. Je n’écris que lorsque je sais que je dois écrire mes idées sur du papier. Je suis plus paresseux.
Mon premier problème, c’est que je ne pouvais pas taper au clavier, je n’ai jamais eu le temps d’apprendre. Je suis devenu écrivain très soudainement. En 1972, j’étais écrivain depuis 3 ou 4 mois, et les gens du NME essayaient de relancer le magazine avec une nouvelle formule. Je faisais partie de ces jeunes types, plutôt marrants, sur lesquels on comptait au début des année 70. Tout le monde attendait le retour des sixties, la reformation des Beatles et le retour de Dylan. Le seul groupe qui avait survécu au passage des 60 au 70, c’était les Rolling Stones, le meilleur groupe du monde à ce moment-là. Le NME m’a donc engagé, en me promettant que quelqu’un taperait mes articles à la machine. Cela devait être un cauchemar pour ces secrétaires, j’écrivais particulièrement mal. Mais je connaissais mon sujet, avec un grand spectre d’écoutes en matière de musique, de la pop au classique, avec une bonne compréhension du jazz. Et j’avais surtout de bons instincts.
Le magazine se vendait bien, à l’époque ?
Nick Kent : Le NME avait 60.000 lecteurs par semaine quand je suis arrivé. 6 mois plus tard, il y en avait 200.000 par semaine. L’éditeur m’avait appelé dans son bureau pour m’annoncer la nouvelle. La maison, qui s’appelait IPC, avait mené un sondage pour en savoir la raison. J’espérais que cela allait être moi, qu’il allait me féliciter… Mais les gens ne lisaient pas le journal, ils s’intéressaient surtout aux photos. Ils voulaient voir les fringues de Roxy Music, la dernière coupe de David Bowie, si Led Zep allait faire un concert… La télévision ne s’intéressait pas à la musique. Les gens voulaient de l’information, pas forcément de l’opinion. C’est aussi pour cela que la presse musicale disparaît, parce que la «news» s’est reportée sur Internet. Plus besoin d’attendre, et les images sont directement là, plus besoin de quelqu’un pour raconter. C’était l’Âge d’Or, mais surtout parce que la presse musicale était le seul endroit où trouver ces infos.
Comment avez-vous réagi à la nouvelle ?
Nick Kent : C’est à ce moment-là que j’ai décidé de verser dans l’extrême. Quand j’avais 15 ans, j’ai vu Jimi Hendrix en concert, il y avait Pink Floyd, avec Syd Barrett, sur la même affiche. Et The Move, un groupe presque aussi bon que celui d’Hendrix. Ils ont fait deux passages, de 18 heures à minuit, devant un millier de personnes, pas plus. Le premier se déroulait devant des écoliers, et Jimi Hendrix était incroyablement puissant, très sexuel. L’équivalent, ce serait de mettre une classe devant un porno, parce que Hendrix jouait de sa guitare comme avec un sexe, complètement extrême, mais il avait leur attention. L’assemblée venait voir de gentils groupes Blancs bien mis, et les écolières se retrouvaient devant un Noir portant l’afro et jouant une musique terriblement sexuelle, quand on voyait encore peu de gens de couleur. Les extrêmes, comme Jerry Lee Lewis au piano ou les Who et leurs guitares qu’ils explosaient. Il faut attirer l’attention.
Face à la concurrence, c’est ce qui vous a permis de vous démarquer ?
Nick Kent : Il y a le risque de n’être identifié plus que par ça, cette partie «choc». Les gens ne prennent plus forcément au sérieux. C’était le problème de Jimi Hendrix : un des plus grands musiciens de la fin du XXe siècle, avec John Coltrane et Miles Davies, mais quand les gens ont vu qu’il jouait avec les dents, ils ont cru que c’était une putain de blague. Les musiciens de jazz ne le prenaient pas au sérieux, aussi bon pouvait-il être. Il avait pourtant le talent qu’il faut développer pour renforcer ce côté improbable. Les journalistes rock étaient bons, mais ils oubliaient qu’ils avaient pour interlocuteurs une audience aux faibles capacités de concentration, des adolescents. Il faut les attraper, et faire en sorte qu’ils n’oublient pas.
Comment vous regardaient les musiciens de l’époque, étant donné votre réputation ?
Nick Kent : Les musiciens autorisaient alors les journalistes à les suivre parce qu’ils voulaient montrer qu’ils étaient grands, qu’ils avaient leur avion, ceci ou cela. Souvent, pour convaincre leurs propres parents qu’ils n’étaient pas des branleurs. C’était très important pour eux. Je me souviens du Velvet Underground qui m’avait appelé en me demandant de supprimer toutes les références à la drogue, parce que ses parents devaient lire l’interview. Avec Maxime Leforestier, ok, mais c’était les putains de Velvet Underground, ils ont fait « Heroin » !
Chez les musiciens que vous avez fréquentés, les extrêmes sombres semblent vous intéresser… L’aviez vous perçu comme tel avant d’écrire The Dark Stuff [recueil d’articles sur l’autodestruction de certains artistes] ?
Nick Kent : Pour verser dans ces extrêmes, il faut un peu les vivre. Et cela conduit à une part d’autodestruction, parce qu’on vit des choses sans les endurer réellement. Quand Iggy Pop fait son truc, il devient un guerrier viking, un Mohammed Ali, difficile d’avoir envie de se mesurer à lui. Mais, quand il y avait une bagarre, il n’était jamais au premier rang. Keith Richards a des flingues, mais je ne sais pas s’il pourrait s’en servir.
Ce n’était donc souvent que pure image ?
Nick Kent : Ils ont créé cette image de gros durs, et ont commencé à y croire. Ils ont du s’entourer de personnes qui étaient vraiment infréquentables pour commencer à y croire. C’est ce qu’il s’est passé avec Led Zeppelin, qui voulaient asseoir leur autorité, leur puissance. Ils se sont entourés de véritables criminels psychopathes, à la fin. Keith Richards connaissait aussi de fameux lascars, parce qu’il prenait de l’héroïne. Les Stones ne connaissaient pas San Francisco, ni les Hell’s Angels. Altamont, c’était pour ce côté démoniaque qui plaisait alors à Jagger, et qu’il voulait que l’on ressente dans le film [Gimme Shelter, NdR], avec la magie noire. Le film Performance suit exactement le même déroulé. Jagger se frotte à des animaux, mais on ne rigole pas avec ces hors-la-loi.
Quelle a été votre éducation musicale ?
Nick Kent : Mes parents n’aimaient pas les Rolling Stones, surtout avec les gros titres. Ils ne m’auraient jamais autorisé à aller aux concerts, mais j’y allais quand même. Ils n’aimaient pas le rock, ni la pop, il n’aimaient pas Frank Sinatra, ou même Glenn Miller. Uniquement de la musique classique. J’avais un radiogramme, avec une petite platine sur le dessus. J’écoutais beaucoup Radio Luxembourg, c’est là où j’entendais cette musique entre 18 et 21 heures. Des classiques Motown, ou les premières chansons des Beach Boys. Mon père était preneur de son, il a travaillé pour Radio Luxembourg dans les années 1950, sous un autre format, avec des performances live en direct de groupes pop britanniques un peu pourris. Ils n’aimaient pas la musique, ni l’influence qu’elle avait sur moi. Mais il n’y avait pas vraiment de grande cause de rébellion : aux États-Unis, ils avaient le Viétnam, et nous avions juste la longueur de nos cheveux.J’ai appris la guitare quand j’étais jeune, et la lecture des notes pour des cours de piano. Je peux en jouer avec dix doigts. Je n’en ai pas joué depuis des années, mais je n’étais pas mauvais. J’aurais pu être dans un groupe de rock progressif, parce que je jouais très bien du Debussy. Mais pas du Jerry Lee Lewis.
Votre carrière est jalonnée de passages dans des groupes : pourquoi ces expériences étaient-elles temporaires ?
Nick Kent : Mon premier groupe, c’était les Sex Pistols, avant John Lydon, où je jouais simplement de la guitare. Steve Jones pouvait à peine en jouer, je devais lui montrer les accords de base. J’ai travaillé avec le groupe The Damned, avec qui nous avions sorti la première version de New Rose, qui est censée être la première chanson punk britannique. J’avais mon propre groupe, The Subterraneans, avec Glen Matlock, Henry Padovani… Je n’avais pas le tempérament d’un musicien professionnel. Et quand on était leader, il fallait trier les gens, les rembarrer parfois, je n’aime pas faire ça. Faire de la musique ne m’a pas aidé dans ma carrière.Je cherchais dans la musique l’idée du groupe, de ce mélange musical avec d’autres personnes. Écrire, c’est être seul et suer de son côté, la musique paraît totalement différente. Je n’aurais pas aimer voyager, avoir toutes ces responsabilités.
Qu’aviez-vous voulu faire à travers Apathy for the Devil ?
Nick Kent : Un livre a propos des seventies, à la fois un mémoire, mais aussi un peu plus… Les années 1970 sont plus que les Sex Pistols ou Bruce Springsteen, ils ne prenaient qu’une chose dans la décennie. Je voulais montrer que c’était Marc Bolan pendant un mois, puis David Bowie, et ensuite Bohemian Rapsody de Queen, et seulement les Sex Pistols. C’était aussi un moyen de rassembler ce que je savais sur des gens que je connaissais bien, comme Iggy Pop ou Keith Richards, avec un point de vue unique. Quand je traînais avec les Stones, j’étais déjà en contact avec Malcolm McLaren, avant les premiers jours des Sex Pistols.
McLaren ne jouait pas, il n’était pas musicien. Il fournissait les idées, il était le concepteur de tout ça, la force pensante. Il avait le nom des Sex Pistols, qui étaient un moyen pour lui de prendre sa revanche sur les New York Dolls, qui l’avaient remerciés quand il avait proposé ses services.
Avez-vous envisagé d’autres formats d’écriture ?
Nick Kent : J’ai écrit la moitié d’un roman, qui se déroule dans le milieu de la musique et met en scène des musiciens, mais c’est une fiction complète, pas un roman à clefs. J’espère, du moins, qu’ils seront entièrement fictifs.
Entretien réalisé le 19 avril 2014 à Deauville, pour le Festival Livres et Musique